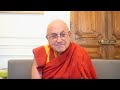mercredi 28 janvier 2026
Danse du temps
mardi 27 janvier 2026
lundi 26 janvier 2026
Accepter les névroses cachées
dimanche 25 janvier 2026
Tragédie et joie
samedi 24 janvier 2026
Maladie et mort
Que voulez-vous dire?
C.A. : Notre équipement neurobiologique n’est pas conçu pour affronter tranquillement l’idée de notre propre mort : comme un animal entre les griffes d’un prédateur, l’humain doit se battre jusqu’au bout pour sa survie. Concevoir notre finitude reviendrait, pense-t-on, à se laisser dévorer sans bouger. Donc on se débat, on refuse la possibilité de mourir, on évite même d’y penser. Toutes les civilisations ont tenté d’apprivoiser la mort, de lui trouver un sens, une explication : « N’ayez pas peur, il se passera des choses après, et vous y aurez accès si vous vous comportez bien. » Ça ne suffit pas. La mort reste un impensé total, et on continue de faire des efforts désespérés pour ne pas voir l’éléphant au milieu de la pièce. Si c’est comme ça qu’on tient, très bien. Mais à certains moments, quand la fin approche ou se précise, on n’a plus le choix : parler de ses peurs peut alors nous amener à une forme de paix. C’est ce qu’on a voulu faire dans ce livre : accompagner le lecteur sur ce chemin où il fait face à ce qu’il redoute.
Au printemps 2015, on vous a diagnostiqué un cancer du poumon, dont vous êtes aujourd'hui guéri : comment avez-vous vécu cette traversée?
C.A. : D’abord avec une certaine difficulté à accepter la réalité : on a découvert ce cancer tout à fait par hasard. Je ne fumais pas, je ne toussais pas, je n’avais pas maigri, j’étais, certes, un peu fatigué, mais pas plus que ça. En tout cas, aucun symptôme qui aurait pu m’alerter, voire me préparer au diagnostic - si tant est que ce soit possible. J’avais, en revanche, une tumeur au rein, et il a fallu vérifier si elle ne s’était pas propagée sur une autre partie du corps : c’est là qu’on a découvert ce cancer du poumon. J’étais sidéré : pour la première fois de ma vie, j’avais une maladie potentiellement mortelle. Je suis alors passé par le tourbillon d’émotions propres à ces moments-là : il y a de la peur, évidemment, de la colère, de l’envie, même, vis-à-vis de ceux qui, eux, ont fumé ou fument, et pourtant n’ont rien. Mais chez moi, la tristesse a vite prédominé : alors ça y est, c’est déjà fini? Les gens, les endroits, les choses que j’aime, je vais devoir les quitter? Pendant la batterie d’examens qui a suivi, je guettais, sur le visage des médecins, le moindre signe qui m’indiquerait si, oui ou non, mon heure avait sonné. C’était terrible, parce que dans le même temps, je comprenais combien la vie était formidable, et comme je chérissais la mienne. Certes, elle n’était pas sans stress, voire sans emmerdes, mais quand même ! Très vite, ce diagnostic a recalibré mon regard sur les blessures du quotidien.
Que se passe-t-il, pour vous, une fois le diagnostic posé?
C.A. : J’ai eu la chance de pouvoir éviter la chimiothérapie comme la radiothérapie - donc de longs mois de traitements pénibles et douloureux. Mais on m’a enlevé la moitié du poumon, plus les ganglions autour. C’était une très grosse opération, qui a provoqué, chez moi des réactions assez incroyables. La veille, j'ai eu un choc mystique. Pas banal, pour quelqu’un qui. comme moi, vient d’une famille de militants communistes - enfant, on m’avait appris à chanter L’Internationale quand je voyais un curé. Je suis devenu croyant sur le tard, parce que j’ai trouvé un certain réconfort dans la foi. En revanche, je pratique peu. Je vais rarement à la messe, et disons qu’intérieurement j’oscille un peu. Mais là, le soir précédant l’opération, je me retrouve dans la chapelle de l'hôpital et je me mets à prier. Happé par un cocktail d’espérance, d’angoisse et de tristesse, je ressens l’urgence de parler à Dieu. Je commence par le remercier pour toute cette vie qu'il m’a permis de vivre, pour mes études, pour ma femme, pour mes trois filles, pour ces lectures qui m'ont passionné, pour m’avoir fait grandir dans un pays en paix... Et puis, quand même, j’ai la trouille. Justement parce que cette vie, je voudrais quelle continue un peu. Alors je lui dis : « C'est toi le chef, donc c’est toi qui vas décider. Mais franchement. si tu es OK pour me donner un peu plus de temps, je suis preneur. » [Rires] Je suis resté une bonne heure à prier, alternant entre exaltation euphorique et crise de larmes : j’étais en feu. J’ai fini par retourner dans ma chambre, mais j’ai encore connu quelques phases de grande, grande intensité émotionnelle.
Racontez-nous._
C.A. : Par exemple, juste après l’opération. Je suis dans mon lit. avec toutes ces tubulures et ces perfusions, quand j'ai une attaque de gratitude - comme on peut avoir des attaques de panique : éperdu de reconnaissance pour les infirmières, pour mon chirurgien, pour son équipe, je dis mon amour pour la médecine, pour la vie. pour l’humanité... Et je reste dans cet état quasi délirant pendant quinze bonnes minutes. Certes, je recevais de la morphine pour moins souffrir, mais ça n’explique pas tout. Les jours suivants, j’ai pu aussi me retrouver à méditer pendant des heures, comme en lévitation, sans même sentir le temps passer. Bref, la maladie m’a fait connaître des secousses émotionnelles si fortes qu’elle m’a profondément transformé. Je me suis juré de ne jamais oublier l’intensité de ces moments-là. Et de me rappeler, toujours, combien le fait même d'être en vie était passionnant.
vendredi 23 janvier 2026
Quelques pas sur le chemin...
Quelques extraits du livre Kilomètre Zéro de Maud Ankaoua
"Je voudrais te dire une dernière chose avant ton rendez-vous avec Shanti. Chaque instant que tu perds à être malheureuse ne te sera jamais rendu. Tu sais où commence ta vie, mais pas quand elle s'arrête. Une seconde vécue est un cadeau que nous ne devons pas gâcher. Le bonheur se vit maintenant. Si tu penses qu'être ici est une obligation, tu vas vivre des moments difficiles ces prochaines heures, car la montagne est un miroir géant. Elle est le reflet de ton âme... Le reflet de ton état d'être. Tu as le choix de saisir l'opportunité qui t'est offerte, d'expérimenter ce voyage autrement, en arrêtant de comparer ce que tu es, ce que tu sais, ta culture, ton niveau de vie, ton confort. Si tu acceptes d'observer sans juger, avec un regard neuf, en oubliant tout ce que tu as déjà vu, alors malgré toutes ces différences, tu découvriras un monde nouveau dans lequel tu pourras prendre un plaisir supérieur à celui que tu connais."
- Laisse-moi deviner. Je suis persuadé que tu as fait des études brillantes qui t'ont permis de te servir de ton cerveau correctement. C'est bien utile dans de multiples cas. Mais qu'en est-il de ton cœur ? Qui ta appris à l'écouter ? Pour prendre ce genre de décision et n'avoir aucun regret, il ne s'agit pas d'être bon en probabilité, il suffit d'entendre ce battement intérieur. C'est le seul à pouvoir te guider sur le chemin de ta vie, celui qui te correspond, celui qui t'emmènera vers ta réalisation.
II n'est pas question d'agir de façon déraisonnée, mais de calmer les hurlements de la panique pour entendre le chant de tes envies. As-tu écouté ce que ton cœur souhaitait ou te laisses-tu berner par le vacarme de tes peurs ?
- Ce n'est pas facile de garder un état positif !
- Il se travaille comme le corps. Si tu souhaites te sculpter tu devras exercer chaque jour tes muscles et être attentive à ton hygiène de vie. Ce n'est pas en pratiquant une demi-heure de sport par mois et en ingurgitant des aliments gras que tu obtiendras le résultat escompté. Pour l'esprit, c'est pareil. Il te faut surveiller chaque jour tes pensées en tentant de ne pas te laisser polluer par le négativisme. Etre positif, c'est arriver à contrôler nos peurs; croire en nos rêves, les visualiser et laisser entrer les opportunités. Tu as déjà fait le plus important : tu as décidé de la direction en priorisant ta vie. C'est plus simple de prendre la route quand on sait où l'on va.
Maud Ankaoua
--------------------
jeudi 22 janvier 2026
Bulles de pensées
Je remets ce texte fondamental !
mercredi 21 janvier 2026
Forêt primaire où le respect du temps
Le projet de forêt primaire de Francis Hallé :
mardi 20 janvier 2026
Espace intérieur
Apprendre à reconnaître et à habiter véritablement toutes les pièces de son propre espace intérieur (à la fois corporel, mental, émotionnel, énergétique, spirituel).
Même celles que l’on ne voit pas ou ne veut pas voir.
Même celles que l’on préfère sciemment ou malgré soi oublier, ignorer ou délaisser.
Même celles qui ont pu d’une manière ou d’une autre être abîmées, rejetées ou profanées.
Apprendre à reconnaître et à habiter autant que faire se peut tous les angles de ce que l’on est. Le plus honnêtement possible.
Se libérer des compromis et autres arrangements avec soi-même qui peuvent donner l’impression illusoire d’avoir fait le tour de la question avant même qu’elle ne soit posée.
Juste ouvrir l’espace à ce qui est, et laisser la possibilité d’une réceptivité à ce qui dès lors peut à chaque instant de façon renouvelée être rencontré, reconnu et aimé.
Rien d’autre à ajouter, ni à retirer.
***
Sculpture : Bouddha de l’empire Qin du Nord, Chine, VIème siècle
---------------------------
lundi 19 janvier 2026
Balayer la cour du temple
dimanche 18 janvier 2026
Au delà de l'Eau
J'ai eu la grâce de me trouver devant l'amour infini à New-Delhi en 1972
Ma se reposait dans sa chambre, quand on l'entendit s'exclamer : « De l'eau ! De l'eau ! » Pensant qu'elle avait soif, une jeune fille vint lui porter un verre d'eau fraîche. Ma secoua la tête : « Non, non, il y a de l'eau partout ! » La jeune fille n'y comprenait rien. Ce jour-là, une mère était venue avec ses deux enfants. Ils étaient allés jouer près d'un bassin et étaient tombés à l'eau. Ils reviennent dégoulinants vers leur mère bouleversée et tout agités s'écrient qu'une jolie dame (la même qui le matin leur avait donné des guirlandes de fleurs) était venue les tirer de l'eau ». Au même moment, Ma, sur son lit, s'exclamait : « De l'eau ! De l'eau ! »
-----------------
samedi 17 janvier 2026
Tout coule
vendredi 16 janvier 2026
Etre entier.
Chères amies, chers amis,
Quoi que vous fassiez, faites-le complètement. Soyez entiers, conscients et présents des pieds à la tête.
Si vous percevez une dissonance entre votre cœur, votre esprit et votre corps, enquêtez, observez.
Que se passe-t-il ? Qu’est-ce qu’essayent de vous dire le corps et le cœur que votre mental étouffe, nie, bafoue.
Osez être vous-même, osez être vrai, en dehors de tout modèle, de tout idéal. Il ne s’agit en aucun cas de complaisance égotique mais de laisser se dévoiler le Soi.
Vous êtes une fleur unique dans le jardin de l’Absolu. Honorez votre singularité, cessez de la travestir afin qu’elle puisse irradier la vérité de son origine.
Nathalie Delay
----------------